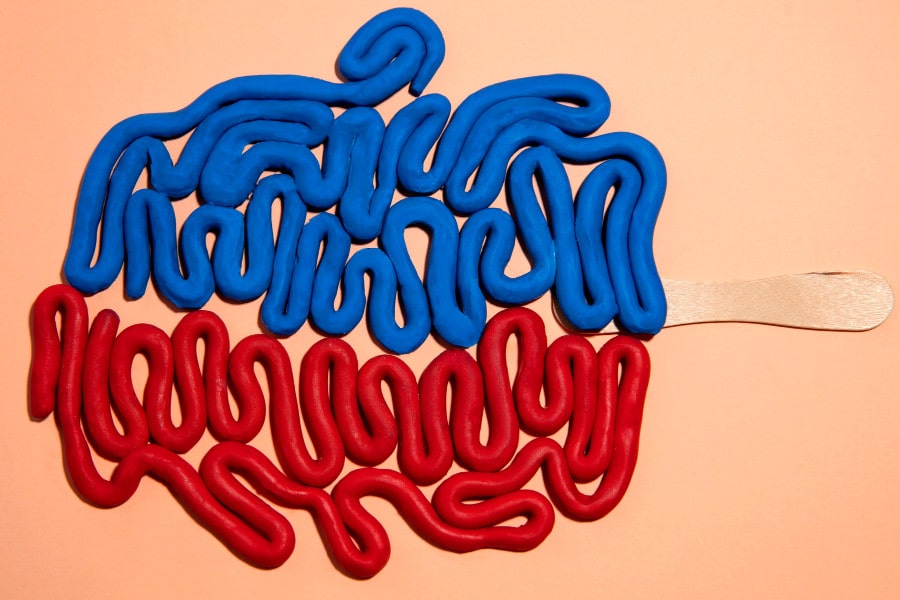Danger Sucralose : Mythe ou Réalité ?
"Le meilleur moyen de rester en bonne santé, c’est de manger ce que vous ne voulez pas manger !"
Auteur Shihan DEV
Tous niveaux
Le sucralose, un dérivé chloré du sucrose, est un édulcorant non calorique de haute intensité, environ 600 fois plus sucré que le sucre de table. Il est largement intégré dans les compléments alimentaires pour améliorer la saveur sans ajouter de calories significatives, notamment dans les produits destinés à la gestion du poids, au contrôle du diabète et à la nutrition générale. Approuvé par la FDA en 1998 pour une utilisation dans 15 catégories alimentaires, y compris les compléments, puis étendu à un usage général, le sucralose a fait l’objet d’évaluations de sécurité approfondies (Approbation FDA). Cet article fait une revue synthétique de la littérature scientifique actuelle sur la sécurité du sucralose, en se concentrant sur les dangers potentiels et le consensus sur son utilisation dans les compléments alimentaires au 27 février 2025.
Évaluations de la sécurité et le danger du sucralose
Les organismes réglementaires ont effectué des évaluations rigoureuses pour établir la sécurité du sucralose. L’approbation de la FDA repose sur plus de 100 études couvrant plus de 20 ans, évaluant la toxicocinétique, la génotoxicité et les effets chroniques chez les animaux et les humains (Édulcorants à haute intensité). L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Comité mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires (JECFA) ont également conclu que le sucralose est sûr dans les limites de l’apport quotidien acceptable (AQA), fixé à 15 mg/kg de poids corporel par la FDA et à 5 mg/kg par l’EFSA, reflétant des marges de sécurité conservatrices.
Principales conclusions
- Absorption et excrétion : Environ 85 % du sucralose ingéré n’est pas absorbé et est excrété inchangé dans les selles, les 15 % restants étant rapidement éliminés par l’urine, ce qui contribue à son impact calorique négligeable (Quoi savoir sur le sucralose).
- Études toxicologiques : Des études à long terme sur les animaux, y compris des bioessais sur les rongeurs sur 2 ans, n’ont montré aucune preuve de cancérogénicité ou d’effets indésirables significatifs à des doses bien supérieures aux niveaux de consommation humaine (Revue de sécurité).
A priori, aucun problème avec le sucralose ! Mais attendez la suite !
Preuves cliniques chez l’homme du danger du sucralose
Les études cliniques humaines se sont principalement concentrées sur les effets métaboliques, notamment chez les personnes diabétiques. Ces études n’ont révélé aucun impact significatif sur le contrôle glycémique, les niveaux d’insuline ou les profils lipidiques, soutenant son utilisation dans les compléments adaptés aux diabétiques (Sécurité clinique). Cependant, la littérature manque d’essais humains à long terme spécifiquement axés sur l’utilisation dans les compléments, ce qui constitue une lacune dans les preuves actuelles.
Préoccupations émergentes et controverses sur le danger du sucralose
Malgré le consensus général sur la sécurité, des recherches récentes ont mis en lumière des risques potentiels, alimentant les débats en cours :
- Altérations du microbiote intestinal : Des études suggèrent que le sucralose pourrait perturber la composition du microbiote intestinal, réduisant potentiellement les bactéries bénéfiques. Par exemple, une étude de 2008 par Abou-Donia et al. a révélé des changements significatifs dans la flore intestinale des rats à des doses aussi faibles que 1,1 mg/kg/jour, soulevant des préoccupations sur la santé intestinale (Impact sur l’intestin). Les études humaines montrent des résultats mitigés, une revue de 2019 ne trouvant aucune preuve concluante d’impacts négatifs à des niveaux de consommation typiques (Sucralose et intestin).
- Génotoxicité des métabolites : Une étude de 2023 de l’Université de Caroline du Nord a identifié le sucralose-6-acétate, un métabolite et une impureté de fabrication, comme génotoxique, provoquant des cassures d’ADN in vitro (Étude sur les dommages à l’ADN). Cette découverte est significative, car des échantillons commerciaux de sucralose contenaient jusqu’à 0,67 % de ce composé, et l’acétylation intestinale pourrait augmenter l’exposition. Cependant, l’étude était in vitro, et ses implications pour la santé humaine, notamment dans les compléments, nécessitent une validation supplémentaire.
- Effets immunomodulateurs : Une étude de 2023 dans Nature a révélé que des doses élevées de sucralose chez des souris limitaient la prolifération des cellules T, suggérant des effets immunomodulateurs potentiels qui pourraient affecter les réponses immunitaires (Effets immunitaires avec le sucralose). Cela est particulièrement pertinent pour les compléments consommés régulièrement, mais les doses utilisées étaient bien supérieures à l’apport humain typique, limitant l’applicabilité directe.
Analyse comparative : Sécurité vs Risques
| Aspect | Preuves en faveur | Préoccupations soulevées |
|---|---|---|
| Approbation réglementaire | FDA, EFSA, JECFA approuvent comme sûr dans les limites AQA (15 mg/kg FDA, 5 mg/kg EFSA) | Aucune directement, mais études récentes incitent à une réévaluation |
| Santé intestinale | La plupart des études humaines montrent aucun impact significatif à doses typiques (Revue sur l’intestin) | Études sur rats montrent des changements dans le microbiote ; études humaines mitigées, certaines suggèrent une dysbiose (Impact sur l’intestin) |
| Génotoxicité | Aucune preuve dans les études à long terme sur animaux (Revue de sécurité) | Sucralose-6-acétate trouvé génotoxique in vitro, risque potentiel de cancer (Étude sur les dommages à l’ADN) |
| Effets immunitaires | Généralement considéré comme sûr, aucune donnée humaine significative | Études sur souris à fortes doses montrent une suppression des cellules T, pertinence pour l’homme incertaine (Effets immunitaires) |
| Santé à long terme | Aucun effet indésirable significatif dans les essais cliniques | OMS lie aux risques accrus de diabète, maladies cardiovasculaires dans des études de cohortes, recommandation conditionnelle (Directive de l’OMS) |

Sucralose = danger ?
Position de l’OMS sur le sucralose
En mai 2023, l’OMS a publié une directive déconseillant l’utilisation des édulcorants non sucrés (ENS), y compris le sucralose, pour le contrôle du poids ou la réduction des risques de maladies non transmissibles, sur la base d’une revue systématique montrant l’absence de bénéfices à long terme pour la perte de poids et des risques potentiels comme une augmentation du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires (Directive de l’OMS). Cette recommandation est conditionnelle et non une évaluation toxicologique de la sécurité, alignée sur les limites AQA existantes fixées par le JECFA. Cependant, des critiques estiment qu’elle ignore les données d’essais montrant des bénéfices à court terme et des études de cohortes rigoureuses, appelant à une réévaluation (Recommandations).
Le danger du sucralose dans les compléments alimentaires
Bien que la littérature aborde principalement le sucralose dans les aliments et les boissons, son utilisation dans les compléments alimentaires – souvent sous forme concentrée – peut nécessiter une attention supplémentaire. Les compléments peuvent contenir des doses plus élevées par portion, dépassant potentiellement l’apport alimentaire typique, bien que restant dans les limites AQA pour la plupart des utilisateurs. Une étude de 2022 a révélé que 48 mg/jour de sucralose augmentaient l’insuline sérique et induisaient une dysbiose intestinale chez l’homme, suggérant des effets possibles à des doses plus élevées (Dysbiose intestinale). Cependant, les études spécifiques sur les formulations de compléments sont rares, et les preuves actuelles penchent vers la sécurité dans les lignes directrices réglementaires.
Dégradation chimique et danger du sucralose sous l’effet de la chaleur
En tant qu'édulcorant artificiel intense, le sucralose (E955) est souvent présenté comme « thermostable » par les fabricants, c’est-à-dire pouvant être utilisé en cuisson sans perte de pouvoir sucrant (Aspartame et autres édulcorants dans la nourriture). Cependant, les études scientifiques de la dernière décennie montrent que sa molécule n’est pas inerte à la chaleur et qu’elle subit des dégradations significatives dès des températures modérées.
À basse température (≤100 °C)
Des expériences ont révélé qu’à des températures proches de l’ébullition de l’eau, le sucralose commence déjà à se décomposer. Par exemple, chauffé 85–90 °C pendant 1 h, le sucralose subit une dégradation notable (changement de couleur, instabilité chimique) par rapport au sucrose qui reste stable dans les mêmes conditions. Cela suggère qu’une exposition prolongée même à des températures inférieures à 100 °C peut entamer l’intégrité du sucralose. Néanmoins, sur de courtes durées (quelques minutes) et en milieu très aqueux, la dégradation reste limitée, ce qui explique que le sucralose conserve généralement son goût sucré dans une boisson chaude consommée rapidement.
À basse température moyenne (~120–150 °C)
Le point de fusion du sucralose est d’environ 125 °C, température à laquelle la molécule entre en décomposition quasi instantanément. Des analyses thermo-gravimétriques couplées à la spectroscopie ont montré qu’autour de 120 °C, le sucralose fond puis se décompose en perdant environ 17–20 % de sa masse, avec émission de composés volatils. Autrement dit, dès les températures typiques de cuisson au four (120–150 °C), le sucralose n’est plus stable : la rupture de sa structure (un diholoside chloré dérivé du saccharose) s’enclenche presque immédiatement après la fusion. Cette instabilité a été constatée indépendamment par plusieurs laboratoires : des études menées aux États-Unis, au Canada et au Brésil ont toutes conclu que le sucralose se décompose lorsqu’il est chauffé à des températures de l’ordre de 125 °C ou plus. Ainsi, pendant la cuisson au four, une partie du sucralose ajouté dans une recette est forcément dégradée en d’autres composés.
À haute température (>180 °C)
Aux températures très élevées de friture, grillage ou pyrolyse (≥180–250 °C), la décomposition du sucralose est poussée beaucoup plus loin. Pratiquement 100 % du sucralose peut alors être dégradé, en quelques minutes ou secondes, en une multitude de fragments chimiques. Des travaux en conditions de pyrolyse (≈250 °C) montrent que le sucralose se déchlorure fortement, libérant du chlorure d’hydrogène (HCl) et rompant ses liaisons pour former des composés organiques plus simples. Au-delà de ~200 °C, les transformations peuvent s’accompagner de réactions de carbonisation et d’aromatisation (formation de structures aromatiques chlorées issues de la carbonisation des sucres). En résumé, plus la température augmente (et/ou plus le temps d’exposition est long), plus la molécule de sucralose se fragmente et génère divers produits de dégradation, en particulier au-delà de ~120 °C où la décomposition s’amorce rapidement.

Sucralose = danger ?
Formation de sous-produits lors du chauffage du sucralose
La dégradation thermique du sucralose s’accompagne de la formation de nombreux sous-produits chimiques, dont certains présentent des structures chlorées potentiellement préoccupantes. Les principales catégories de composés identifiés lors du chauffage de sucralose ces dix dernières années sont résumées ci-dessous :
- Chloropropanols (dont 3-MCPD) : Le sucralose peut engendrer des chloropropanols, en particulier lorsque des polyols comme le glycérol sont présents. Des tests en pyrolyse (250 °C) ont détecté la formation de 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) et de 1,2- et 1,3-dichloropropanols provenant du sucralose chauffé en présence de glycérol. Ces chloropropanols représentent une part importante (jusqu’à ~15 %) des produits volatils générés lors de la pyrolyse du sucralose. Leur formation résulte notamment de la libération de HCl par le sucralose chauffé (dès ~119 °C) et de l’interaction de ce HCl avec des molécules tri-carbonées (glycérol, glycérol des graisses) pour former des propanols chlorés
- Composés chlorés dérivés des sucres (furannes et dicarbonyles) : La molécule de sucralose étant un dérivé chloré du saccharose, sa décomposition génère des fragments de sucres partiellement chlorés. Des études récentes ont mis en évidence pour la première fois des composés tels qu’un furane-3-one chloré et divers dicarbonyles chlorés résultant de la rupture du sucralose. Concrètement, les deux moitiés du sucralose (galactose 4-chloré et fructose 1,6-dichloré) produisent chacune leurs propres sous-produits : par exemple, un fragment de type furanne chloré (analogue chloré du 5-hydroxyméthylfurfural, HMF) autour de m/z 162, issu de la partie fructose, et un tétrahydropyrane chloré (m/z 197) issu de la partie galactose. Ces composés suggèrent des voies de dégradation où le sucralose se scinde en dérivés de sucres aromatisés et chlorés. Par ailleurs, lors de la cuisson avec des aliments, un furandione chloré (composé 1,2-dicarbonylé chloré) a été détecté qualitativement dans des biscuits cuits avec sucralose, confirmant que ces sous-produits chlorés peuvent effectivement se former dans les aliments cuisinés.
- Dérivés du furanne non chlorés (HMF) : Le chauffage de formulations avec sucralose entraîne aussi l’apparition de composés classiques de la caramélisation des sucres. En particulier, on observe une augmentation significative de la production de 5-hydroxyméthylfurfural (HMF) dans les produits de boulangerie contenant du sucralose par rapport aux témoins sans sucralose. Le sucralose semble favoriser la formation de HMF par dégradation de sa partie fructosyle (possiblement via un intermédiaire chloré qui se hydrolyse en HMF). Bien que le HMF produit ne soit pas lui-même chloré, sa présence plus abondante indique une dégradation accentuée du sucre en milieu peu humide. Le HMF est un marqueur de chauffage intense des sucres et peut avoir des implications toxicologiques (voir section suivante).
- Composés volatils chlorés légers : Lors de la décomposition thermique, des molécules volatiles de faible poids moléculaire sont libérées. Deux en particulier ont été détectées par spectroscopie infrarouge : l’acide chlorhydrique (HCl) et le chloroacétaldéhyde. L’émission de HCl est cohérente avec la perte des atomes de chlore du sucralose sous l’effet de la chaleur. Le chloroacétaldéhyde, quant à lui, est un aldéhyde chloré simple, susceptible de provenir de la fragmentation de la structure hexose du sucralose. Ces espèces volatiles se forment au moment même où la masse du sucralose diminue brusquement (lors du palier de 120–130 °C), attestant qu’elles font partie des tous premiers produits de décomposition. Elles sont susceptibles de réagir avec l’environnement de l’aliment (par ex. HCl peut interagir avec d’autres constituants, voir plus bas).
- Dioxines et furannes chlorés (PCDD/F) : Sous des conditions de chauffage extrêmes, le sucralose peut conduire à la formation de dioxines et furannes chlorés polycycliques. Des chercheurs ont montré qu’en chauffant du sucralose à haute température en présence de certaines surfaces métalliques (oxydes de fer, de cuivre, etc.), on générait des polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF) détectables dans les fumées et les résidus. La présence de catalyseurs (comme CuO) accroît notablement les rendements de ces composés hautement toxiques. Ces résultats suggèrent que lorsqu’on chauffe du sucralose en contact avec des matériaux métalliques (ustensiles, parois d’appareils) dans des conditions de grillage ou de combustion partielle, de petites quantités de dioxines/furannes chlorés peuvent se former. Il convient de noter que ces conditions restent extrêmes par rapport à la cuisine ordinaire, mais elles simulent des scénarios de carbonisation d’aliments sucrés contenant du sucralose (par ex. un produit brûlé au four ou en friture).
- Chloration de constituants alimentaires : Fait notable, le sucralose en se décomposant peut transférer du chlore réactif à d’autres molécules présentes dans l’aliment. Une étude a ainsi montré qu’en chauffant du sucralose en présence de protéines, on observe la formation de 3-chlorotyrosine au sein des protéines. La 3-chlorotyrosine est un acide aminé modifié résultant de la chloration d’un résidu tyrosine, et sert classiquement de marqueur de dommages oxydatifs par les hypochlorites. Sa détection indique que des radicaux chlorés ou de l’acide hypochloreux (HOCl) ont pu se former à partir du sucralose chauffé, assez pour chlorer des acides aminés. De même, en présence de glycérol (matrice simulant des lipides/polyols), il a été confirmé que le sucralose chauffé libère du HCl qui va chlorer le glycérol en 3-MCPD et en dichloropropanols. Ces observations suggèrent que les produits de dégradation du sucralose peuvent réagir avec la matrice de l’aliment et engendrer des molécules chlorées dérivées de composants alimentaires (protéines, glycérol, etc.), élargissant la gamme des sous-produits potentiellement formés lors de la cuisson.
Toxicité potentielle des produits de dégradation du sucralose
Plusieurs sous-produits formés par la cuisson du sucralose sont toxiques ou suspectés de l’être, certains appartenant à des familles de contaminants bien connues pour leurs effets délétères. Les principales préoccupations toxicologiques soulevées dans la littérature sont les suivantes :
- Chloropropanols (3-MCPD et DCP): Les chloropropanols générés à haute température (notamment 3-MCPD, 1,3-DCP et 1,2-DCP) sont des composés dont la toxicité est avérée. Le 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) est classé par le CIRC comme cancérigène possible pour l’homme (groupe 2B), de même que le 1,3-dichloropropanol. Chez l’animal, le 3-MCPD provoque des lésions rénales et testiculaires et induit des tumeurs à forte dose prolongée. En raison de ces effets, les autorités ont fixé des doses journalières tolérables extrêmement basses (de l’ordre de quelques microgrammes par kg de poids corporel par jour) pour le 3-MCPD. La présence de 3-MCPD et de dichloropropanols dans les aliments est donc strictement réglementée, et leur découverte comme sous-produits du sucralose chauffé est jugée préoccupante. Même si les quantités formées lors d’une cuisson domestique typique restent à quantifier, le simple fait que ces composés toxiques et potentiellement cancérigènes puissent apparaître incite à la prudence.
- Dioxines et furannes chlorés (PCDD/F): Les polychlorodibenzo-dioxines et furannes font partie des substances les plus toxiques connues en toxicologie alimentaire. La TCDD (2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine) est un cancérigène certain pour l’homme (CIRC groupe 1) et un perturbateur de multiples fonctions biologiques (immunité, reproduction, développement, etc.). Même à des doses infimes (de l’ordre du picogramme par kg), les dioxines peuvent induire des effets néfastes chroniques. La formation possible de dioxines/furannes en chauffant du sucralose est donc un sujet de préoccupation majeure. Bien que les études montrent que ce phénomène requiert des conditions sévères (température très élevée, catalyseurs métalliques), la simple présence de “composés à potentiel cancérogène” de type dioxine ou furanne chloré dans les fumées ou résidus de sucralose chauffé a conduit les experts à considérer un risque pour la santé humaine. Si du sucralose est utilisé dans un contexte où une partie du produit est carbonisée (par exemple, dans un four industriel mal maîtrisé), il existe un risque théorique d’introduction de traces de dioxines/furannes dans l’aliment fini. Ces composés s’accumulant dans l’organisme, toute exposition additionnelle, même minime, n’est pas souhaitable.
- Composés organochlorés réactifs (chloroaldéhydes, furannes chlorés, dicarbonyles) : Au-delà des grandes familles précédentes, le sucralose chauffé génère divers composés organiques chlorés de plus petite taille (ex. chloroacétaldéhyde, furanne chloré, dicarbonyles chlorés). Beaucoup de ces molécules n’ont pas encore fait l’objet d’études toxicologiques approfondies. Néanmoins, par analogie avec des composés similaires, on peut craindre un potentiel génotoxique. Par exemple, les furandiones chlorés forment une classe de sous-produits bien connus de la chloration de l’eau potable (tels que le composé MX, un furandione polyhalogéné) et qui présentent une puissance mutagène élevée in vitro. Il est possible que certains furannes/dicarbonyles chlorés issus du sucralose aient des propriétés comparables, bien que cela reste à confirmer expérimentalement. De même, le chloroacétaldéhyde est un aldéhyde réactif qui pourrait endommager les macromolécules biologiques (ADN, protéines) s’il était ingéré en quantité notable – c’est un composé proche du chloroacétaldéhyde issu du métabolisme de certains solvants, connu pour sa toxicité cellulaire. Pour l’instant, faute de données, le risque exact posé par ces petits composés chlorés issus du sucralose est difficile à quantifier, mais ils contribuent au “cocktail” potentiellement toxique généré par la dégradation thermique.
- Composés de caramélisation (HMF) : Le 5-hydroxyméthylfurfural (HMF), dont la formation est favorisée par le sucralose en milieu sec, est un composé non chloré mais qui présente lui aussi un potentiel cancérogène suspecté. Des études chez l’animal ont montré que des doses élevées de HMF peuvent provoquer des tumeurs du foie chez les rongeurs, via son métabolite actif le 5-sulfoxyméthylfurfural. Bien que l’exposition alimentaire habituelle à HMF (provenant de tous les aliments caramélisés : café, pain grillé, etc.) soit jugée modérée, l’ajout de sucralose dans des préparations pourrait augmenter la teneur en HMF de celles-ci. Le HMF n’est pas réglementé spécifiquement, mais sa présence accrue est un indicateur d’une réaction de Maillard/caramélisation plus intense pouvant aussi générer d’autres toxiques (comme l’acrylamide dans certains cas). Ainsi, l’augmentation d’HMF causée par le sucralose est le signe que l’innocuité globale de l’aliment pourrait être affectée (HMF n’étant qu’un marqueur parmi d’autres).
Conclusion
La littérature scientifique soutient généralement la sécurité du sucralose dans les compléments alimentaires dans les limites réglementaires, avec des données toxicologiques et cliniques étendues appuyant son utilisation. Cependant, les recherches émergentes sur la santé intestinale, la génotoxicité et les effets immunitaires introduisent une incertitude, en particulier à des doses élevées ou avec une utilisation prolongée. Étant donné l’absence d’études spécifiques sur les compléments, les consommateurs et les professionnels de santé devraient surveiller l’apport, notamment chez les populations vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes, et attendre des recherches supplémentaires pour clarifier ces risques. La directive de l’OMS de 2023, bien qu’elle n’aborde pas directement la sécurité, souligne la nécessité d’une utilisation prudente, en particulier à des fins de gestion du poids.
Par ailleurs une revue de littérature scientifique récente converge vers une mise en garde quant à l’usage du sucralose dans les aliments cuits. Les études combinant analyses chimiques de pointe et essais en conditions de cuisson réelles ont mis en évidence la formation de composés indésirables, et bien que l’impact pour le consommateur ne soit pas entièrement quantifié, les experts préconisent d’appliquer une démarche prudente. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mesurer les niveaux de ces sous-produits dans les aliments courants et pour évaluer leur contribution réelle au risque alimentaire. D’ici là, les recommandations actuelles invitent à privilégier le sucralose dans des usages sans chauffage ou après cuisson, en attendant que la science et la réglementation apportent des conclusions définitives fondées sur des données solides
Si vous souhaitez en savoir plus sur la perte de poids sans raison et fatigue, vous trouverez tout dans l’article Comprendre la perte de poids sans raison et fatigue..
FAQ - Questions Fréquentes
Est-ce que la sucralose est bonne pour la santé ?
Le sucralose est un édulcorant artificiel sans calorie, souvent utilisé pour remplacer le sucre. S’il est considéré comme sûr par les autorités sanitaires, des études suggèrent qu’il pourrait altérer la flore intestinale et la réponse glycémique. Son impact à long terme reste incertain, d’où la prudence recommandée.
Pourquoi éviter la sucralose ?
Le sucralose peut perturber la flore intestinale, affecter la réponse glycémique et potentiellement altérer le métabolisme. Certaines études suggèrent aussi des effets négatifs sur la sensibilité à l’insuline et la santé intestinale. À forte température, il pourrait produire des composés toxiques. Son impact à long terme reste incertain.
Est-ce que le sucralose est de l’aspartame ?
Non, le sucralose et l’aspartame sont deux édulcorants artificiels différents. Le sucralose est dérivé du sucre et reste stable à la chaleur, tandis que l’aspartame est composé d’acides aminés et se dégrade à haute température. Leur métabolisme et leurs effets sur la santé diffèrent.
Quel est l’édulcorant le plus dangereux ?
L’aspartame est souvent controversé en raison de ses effets potentiels sur le cerveau et le métabolisme. Le cyclamate est interdit dans certains pays pour des risques cancérigènes. La saccharine a aussi été liée à des inquiétudes. Cependant, la toxicité dépend des doses consommées et de la sensibilité individuelle.
Est-ce que le sucralose est pire que le sucre ?
Tout dépend du contexte. Le sucralose ne contient pas de calories et n’affecte pas directement la glycémie, mais il pourrait perturber la flore intestinale et le métabolisme. Le sucre, en excès, favorise l’obésité et le diabète. Ni l’un ni l’autre n’est idéal, tout dépend de la quantité et de l’usage.
Références
Les derniers articles du blog !
Tous les articles liés à "Danger Sucralose : Mythe ou Réalité ?"

Que manger le soir pour maigrir ?
Pour perdre du poids, le dîner doit être léger, équilibré et riche en nutriments. Privilégiez des protéines maigres (poisson, poulet), des légumes riches en fibres (épinards, courgettes) et une petite portion de glucides complexes (quinoa, lentilles). Évitez les aliments gras, sucrés ou t...